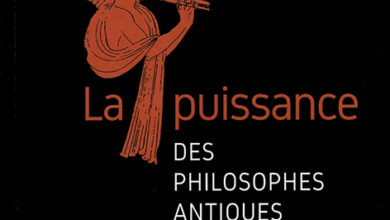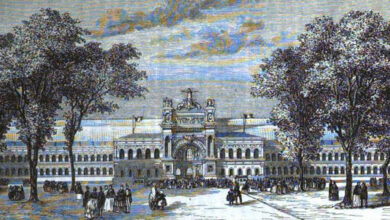Raconte, grand-mère… Ve épisode Après la libération (3)

La vie après la Libération continue à reprendre son cours. L’auteur raconte la vie quotidienne avec ses aïeux, la pénurie alimentaire et le retour des prisonniers de camps de concentration.
On recommence à se déplacer plus volontiers. C’est ainsi que, plusieurs fois, j’ai l’occasion d’aller passer quelques jours au Mans, chez ma grand-mère maternelle.
Ma grand-mère maternelle
Ma grand-mère maternelle, nous l’appelons Ma. Elle est petite, gentille, elle a un rire de petite fille et elle me lit un livre qu’on lui a offert quand elle était elle-même petite et qui s’appelle Mademoiselle Lili aux eaux. C’est l’histoire d’une petite fille dont le papa, malade, va faire une cure dans une station thermale et que sa famille accompagne. Pour faire profiter sa poupée de cire, commune à cette époque, des bienfaits de la cure thermale, elle lui fait prendre un bain dans une source chaude et la poupée fond.
Je suis fascinée par les gravures en noir et blanc qui illustrent le livre et sa magnifique couverture rouge et or. Et par ce que cette histoire d’autrefois a pour moi de totalement inhabituel.
Ma grand-mère adore l’ail et, pour me faire plaisir, elle me fait manger des pâtes assaisonnées de beaucoup d’ail qui brûlent mon gosier de petite fille. Je n’ose ni ne veux la décevoir et lui confirme quand elle m’interroge que, oui, c’est bon.
Ma grand-mère paternelle
Ma grand-mère paternelle, qui habite également au Mans, vient passer quelques jours chez nous à plusieurs reprises. Elle est grande, maigre, tout habillée de noir et a le ventre qui gargouille. Elle est sévère et nous raconte des choses terrifiantes. « Si vous n’êtes pas sages, nous dit-elle, vous irez en enfer. Et, en enfer, il y a une grande horloge et le balancier de cette horloge, continue-t-elle en mimant le mouvement de va-et-vient avec le bras, répète sans arrêt : « Toujours. Jamais. Toujours. Jamais. Toujours tu y resteras. Jamais tu n’en sortiras. »
Il faut savoir que la vie a été dure pour elle. D’une famille de paysans mayennais, elle épousa un artisan tanneur, qui perdit son poste de cadre dans une tannerie à Pont-Audemer dans l’Eure, lors de l’abandon du tannage végétal du cuir, long et polluant, pour une autre méthode, tout aussi polluante mais plus rapide. Il dut se contenter d’un poste plus modeste de comptable et la famille s’installa au Mans. Il mourut en 1926, à 56 ans, d’une crise cardiaque. Mon père, alors âgé de 19 ans, interrompit sa formation professionnelle, à Vincennes près de Paris et revint vivre au Mans pour travailler et soutenir sa mère au Mans où, veuve, elle trouverait plus facilement du travail, elle qui gagnait chichement sa vie comme couturière à domicile.
Elle perdit trois de ses cinq enfants, l’un encore bébé, à quelques mois, sa fille, Georgette à 25 ans de la tuberculose et son deuxième fils, Pierre, à 30 ans, pendant la guerre, à Dunkerque. Quant à son dernier fils, mon oncle Jean, fait prisonnier par les Allemands en 1940, il ne rentra en France qu’après 5 ans de captivité (1).
Elle avait été marquée par une éducation religieuse d’un moralisme rigide et une mentalité doloriste fréquente chez certains chrétiens de l’époque qui croyaient qu’on ne pouvait faire son salut que par la souffrance. C’est ainsi que, lors de sa dernière maladie, elle refusait les antidouleurs, pensant ainsi accumuler des mérites qui lui donneraient plus de chances d’aller au Ciel après sa mort.
Je l’échappe belle
Elle aimerait que mes parents me confient à elle car elle voudrait m’élever comme il convient d’éduquer une petite fille, ce qui, semble-t-il, ne lui paraît pas être le cas de ma mère. Mon père verrait cela d’un assez bon œil. Ma mère, heureusement, oppose un refus catégorique. Je ne me rends compte alors que vaguement de ce qui se passe mais, a posteriori, je frémis en pensant à ce à quoi j’ai échappé.
J’ai beaucoup de chance d’avoir une mère comme la mienne. Nous sommes en promenade avec Tante Nane – la sœur de ma mère dont j’ai déjà parlé et qui est venue nous voir à Verneil-le-Chétif – en vacances chez nous avec mes cousins. Les plus hardis d’entre nous grimpons dans tous les arbres que nous rencontrons et qui s’y prêtent. Ma jupe s’accroche à une branche et se déchire du haut jusqu’en bas. Je viens le dire à ma mère et lui montre ma jupe. Elle me dit que ce n’est pas grave et me renvoie jouer. J’entends ma tante lui dire qu’elle ne devrait pas tolérer cela. Et ma mère lui répond : « Qu’elle joue ! Une jupe, cela se répare facilement ».
L’oie et le père Petron
Une histoire se transmettait de génération en génération dans ma famille paternelle, que ma grand-mère raconta à ses enfants et que mon père et mon oncle nous racontèrent à leur tour. Son personnage principal était le Père Petron, grand-père ou arrière-grand-père de ma grand-mère.
Un soir de 24 décembre, toute la famille partit à la messe de minuit, laissant à la maison le Père Petron, trop âgé pour les accompagner, en charge de surveiller la cuisson de l’oie qui rôtissait lentement, à la broche, dans la cheminée.
En ce temps-là, c’était une oie qu’on mangeait traditionnellement à Noël, au réveillon. Ce n’est qu’ensuite qu’elle fut progressivement remplacée par la dinde, pas meilleure mais plus charnue, originaire d’Amérique et introduite chez nous par les Américains venus en Europe à l’occasion des deux guerres mondiales.
Installé dans son fauteuil devant la cheminée, pénétré de l’importance de sa mission, le Père Petron, pour suivre la cuisson de l’oie, préleva un petit bout de peau, puis un autre… et un autre… Lorsque la famille revint, toute réjouie du réveillon qui les attendait, il ne restait plus dans la cheminée que la carcasse de l’oie. Et le Père Petron, dans son fauteuil, dormait paisiblement.
L’après-guerre
En 1945, année du suicide d’Hitler le 30 avril, et de la capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai, celle où j’ai fêté mon huitième anniversaire, ma famille a quitté le Grand-Lucé pour aller habiter à Blois.
C’est à Blois que nous avons vécu le retour des camps de concentration. Ce n’est qu’à ce moment-là que nos parents nous ont mis au courant de leur existence et des horreurs qui y avaient été commises. Mon père est venu un jour à la maison, accompagné d’un homme d’une extrême maigreur, impressionnante. C’était un rescapé du camp de Dachau, non loin de Munich, en Bavière, délivré fin avril par les Américains.
La pénurie alimentaire perdure. Il faudra attendre février 1949 pour que le pain cesse d’être rationné et décembre 1949 pour que soient supprimés les derniers tickets de rationnement sur le sucre, le café et l’essence.
Dans le haut de la ville, à la lisière de la forêt de Blois, il y avait un camp de prisonniers allemands. L’attitude des habitants à leur égard était ambiguë. Ils vivaient dans des baraquements, travaillaient à la reconstruction et souffraient de la faim. Je me rappelle notre étonnement le jour où nous voyons notre mère nettoyer soigneusement, après l’avoir plumé et vidé, les pattes d’un poulet que mon père a rapporté d’un de ses nombreux déplacements professionnels dans la campagne du département. Elle nous explique que c’est pour les prisonniers allemands et que c’est pour eux une aubaine. Cuites à l’eau, ils trouvent dessus de quoi manger. Des femmes se chargent de leur remettre à travers le grillage qui entoure le camp ce qu’on peut leur donner malgré les restrictions et les interdictions. Les derniers ont été libérés en 1949.